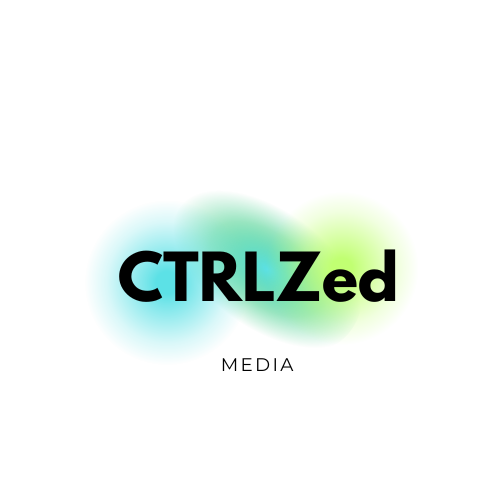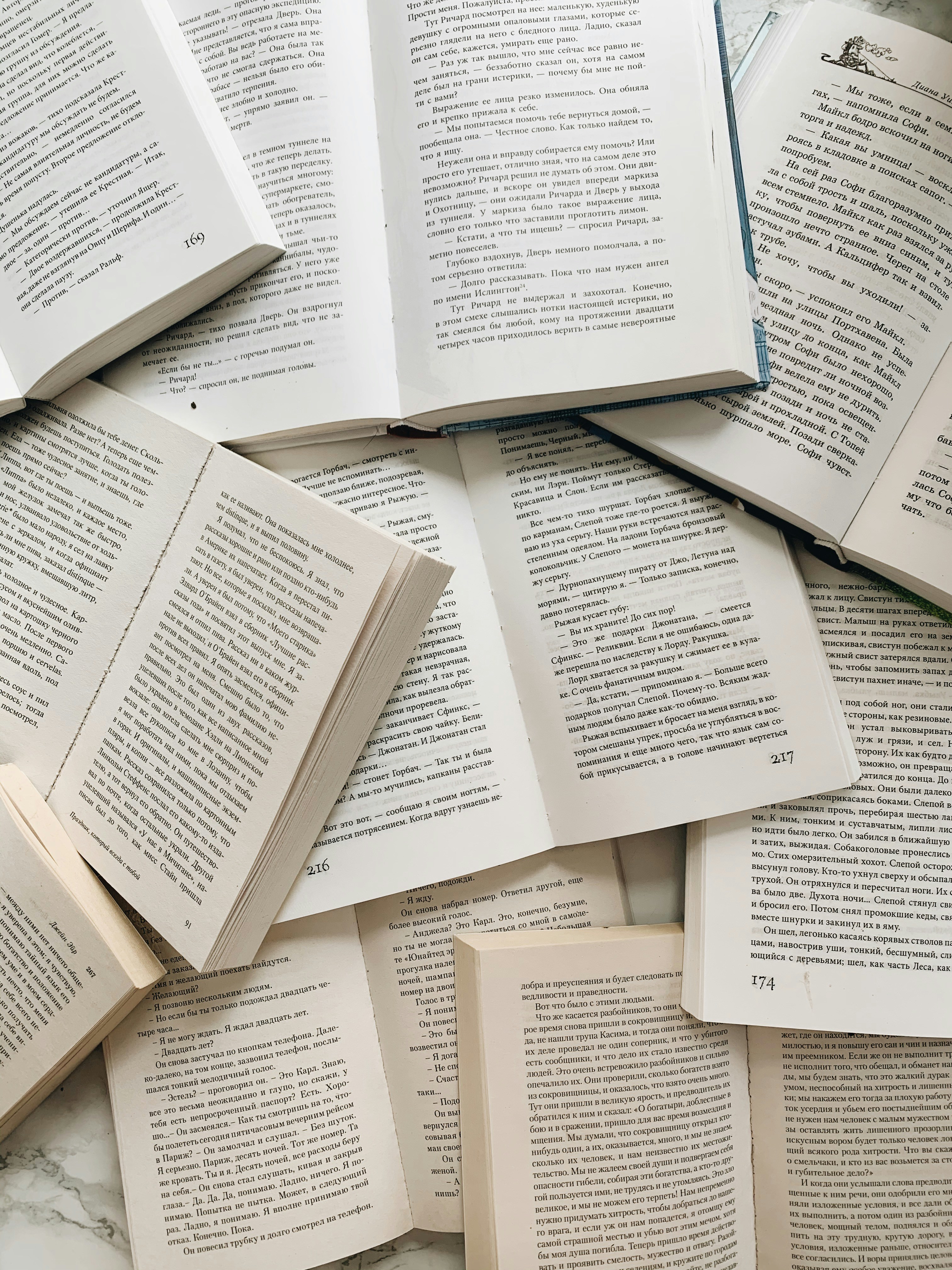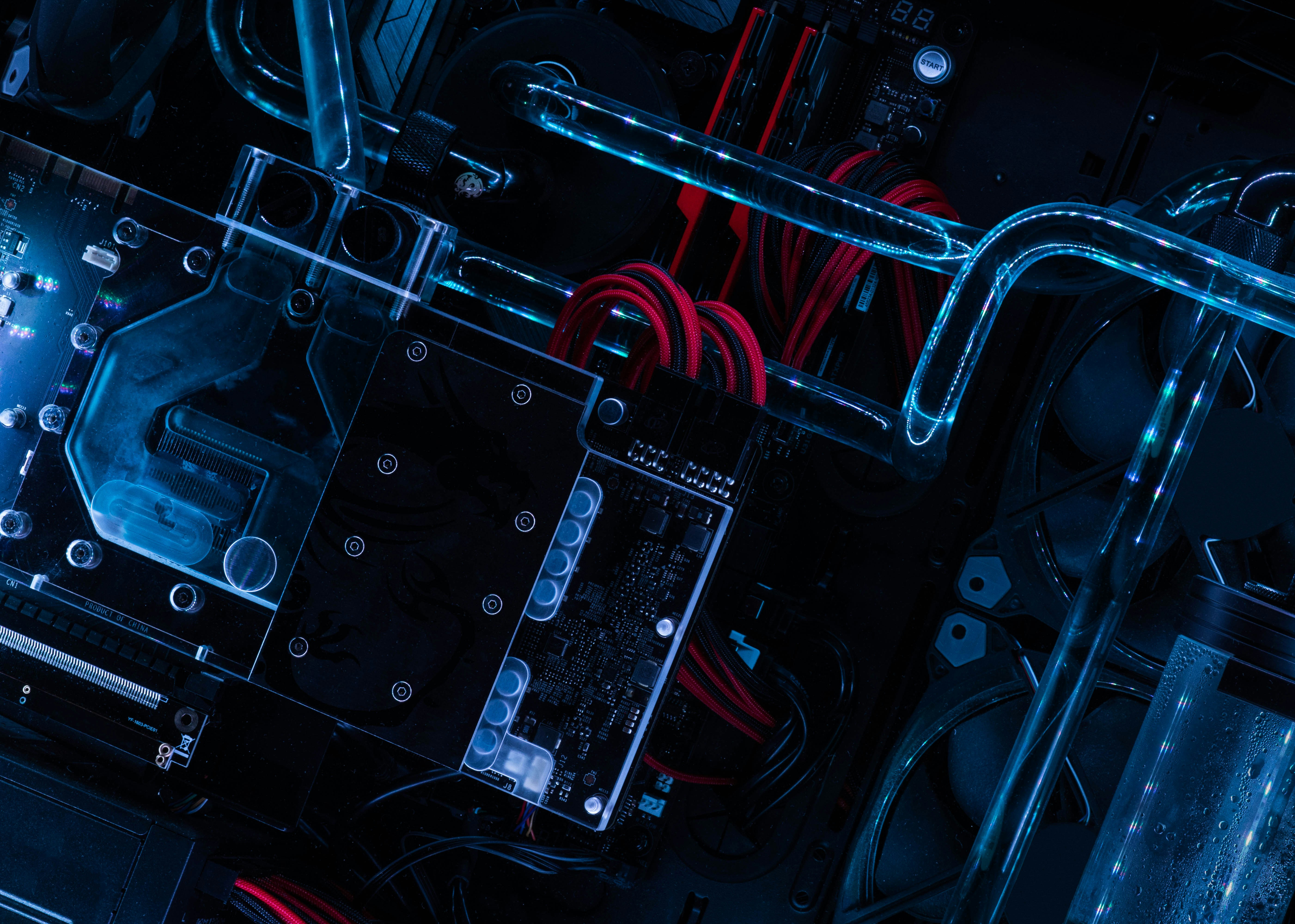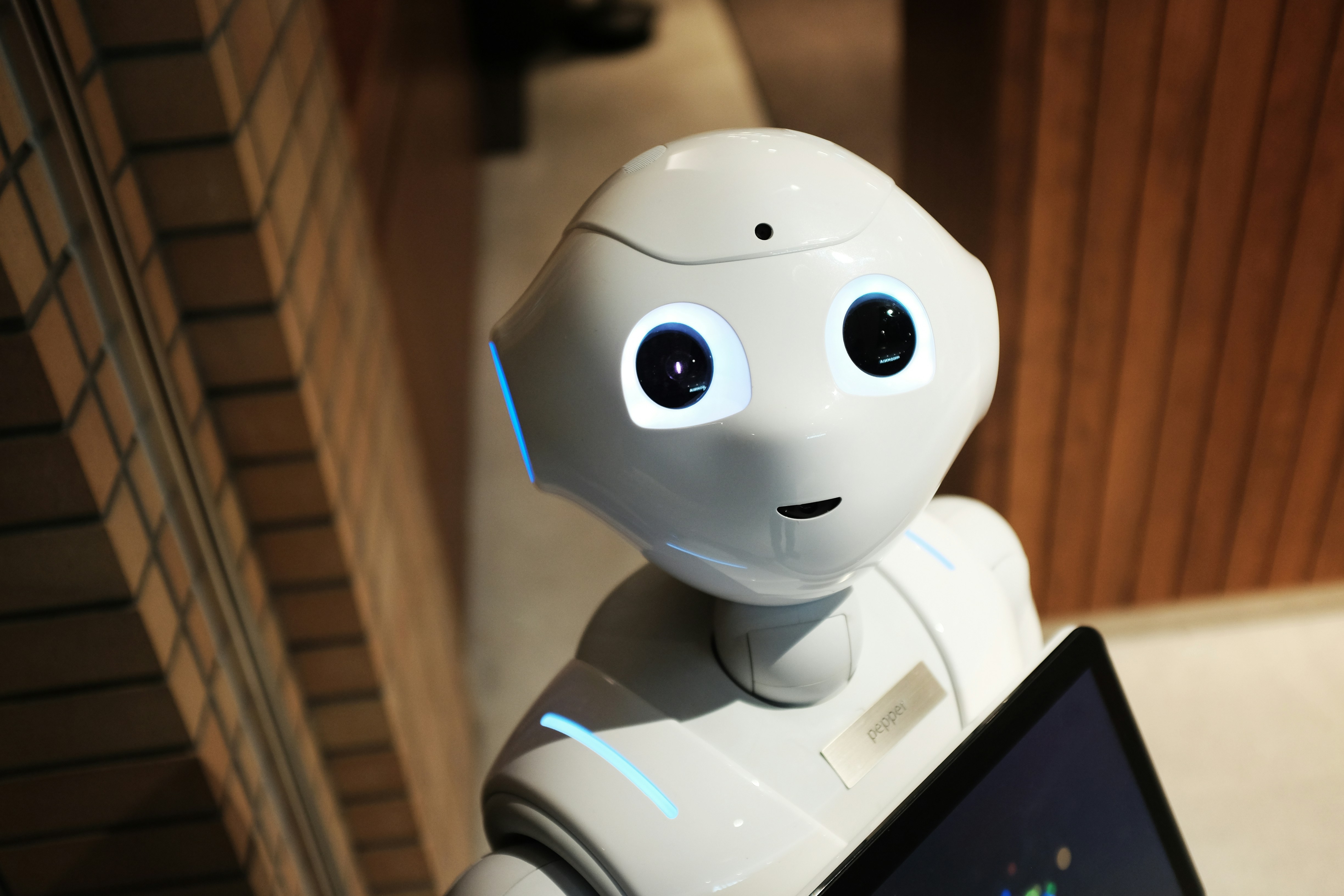Les likes ont-ils remplacé l'estime de soi ?
Autrefois, l'estime de soi se construisait dans le regard de l'autre : celui d'un parent, d'un professeur, d'un groupe d'amis. Aujourd'hui, ce regard passse par un écran - et se mesure en likes. Mais quand l'approbation numérique devient la principale boussole identitaire, que reste-t-il du libre développement de la personnalité, principe fondateur du droit moderne ?
Les likes ont-ils seulement changé notre rapport aux autres - ou ont-ils commencé à juridiciser notre rapport à nous-même ? Cette question, à l'interface du droit, de la psychologie, mérite un vrai détour.
L'estime de soi à l'épreuve du numérique.
Une construction affective menacée
Selon la psychologie du développement, l'estime de soi repose sur trois pilliers. Le premier étant l'amour de soi, ainsi que de la vision de soi et la confiance en soi.
Mais les réseaux sociaux ont déplacé ces trois fondations vers des mécanismes de validation externe et publique, fondés sur la visibilité, l'interaction, et l'approbation chiffrée.
Dès lors, la construction de l'estime de soi n'est plus protégée par l'intériorité : elle devient dépendante d'un espace semi-public. Souvent hors du contrôle de la personne concernée.
Un droit à l'image... soumis à l'algorithme
Ce que dit le droit
L'article 9 du code civil français nous rappelle que "chacun a droit au respect de sa vie privée." Tantôt, la jurisprudence admet depuis longtemps que cela inclut le droit à l'image, lequel suppose le consentement explicite pour toute diffusion.
Seulement, en pratique, sur Instagram ou TikTok, la publication est faite par soi-même, souvent sans conscience des conséquences. L'image devient alors monnayable, commentable, copiable, au mépris de son intimité.
Pourtant, même l'autodifusion n'annule pas la protection : le droit reconnaît qu'on peut être instrumentalisé par des mécanismes addictifs, et ne pas être en état de consentement éclairé.
La protection des mineurs : des textes, peu d'effets

Une population surexposée
La Convention internationale des droits de l'enfant (art 16) protège les mineurs contres les atteintes à la vie privée et garantit leur droit à se développer librement. Or, près de 70% des utilisateurs de TikTok ont moins de 24 ans. Des enfants de 11 ans publient quotidiennement, souvent en quête d'un feedback numérique qu'ils assimilent à une preuve de valeur.
Un encadrement juridique insuffisant
La loi de juillet 2024 oblige les fabricants d'équipement numériques à proposer un contrôle parental automatique. Mais les plateformes ne sont pas encore soumise à des obligations fortes quant à la suppression des likes ou à la des likes ou à la désactivation par défaut du nombre de vues/commentaires. Le droit protège l'enfant dans l'abstrait, mais le laisse exposé dans le concret.
Une interface pensée pour l'addiction : vers une responsabilité des plateformes ?
Le rôle des architectures numériques
Les réseaux sociaux sont conçus pour prolonger le temps d'écran et renforcer l'engagement; Les likes déclenchent de la dopadime (cf. Harvard Medical School, 2016). Les systèmes de notifications sont optimisés pour capter l'attention.
En droit, on parle ici de "dark patterns" : des interfaces conçues pour orienter inconsciemment le comportement de l'utilisateur.
Le Digital Services Act (DSA), entré en vigueur en 2024 dans l'UE, interdit ces pratiques pour les mineurs et impose de la transparence sur les algorithmes, mais son application reste embryonnaire
Une atteinte à la dignité numérique ?
Estime de soi au respect de la personne humaine
Selon la doctrine juridique, le droit à l'identité personnelle implique la liberté de se construire, la maitrise de son image et de ses données, ainsi la protection contre toute réduction à un profil ou à une notation sociale.
Or c'est exactement ce que produit un environnement où le like devient mesure de soi, la personne devient son image, l'image devient sa valeur, et la valeur, et la valeur devient un chiffre public.
C'est une forme douce, mais réelle, de dépersonnalisation algorithmique.