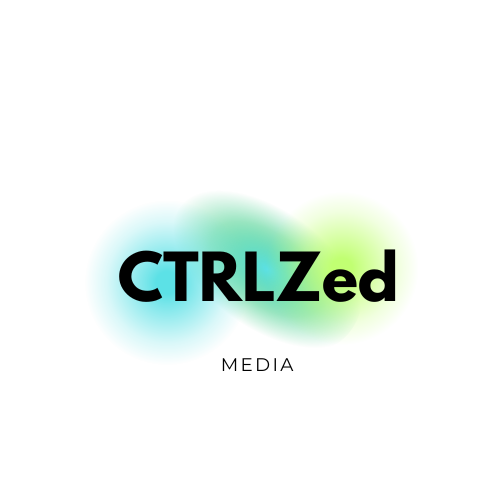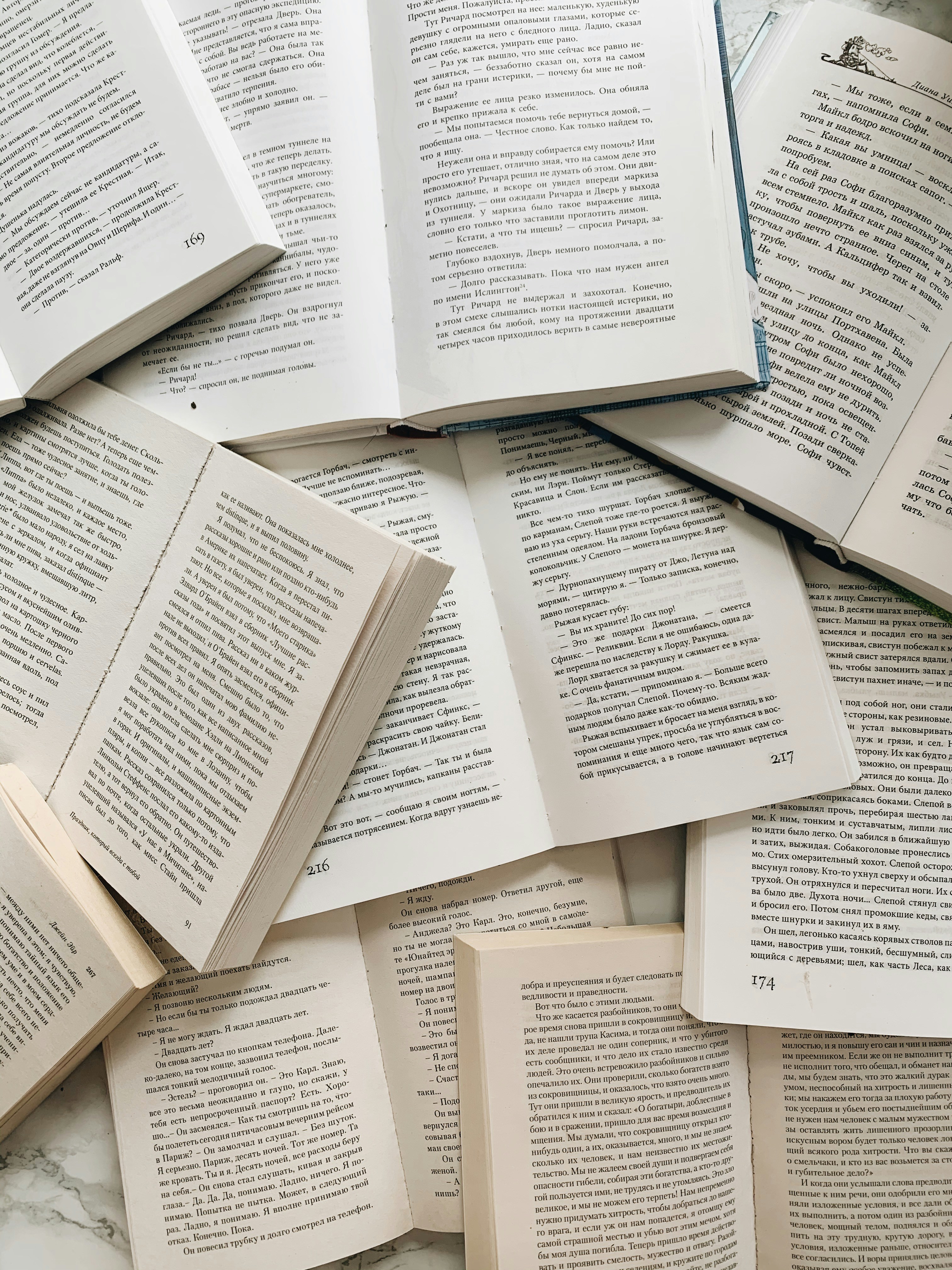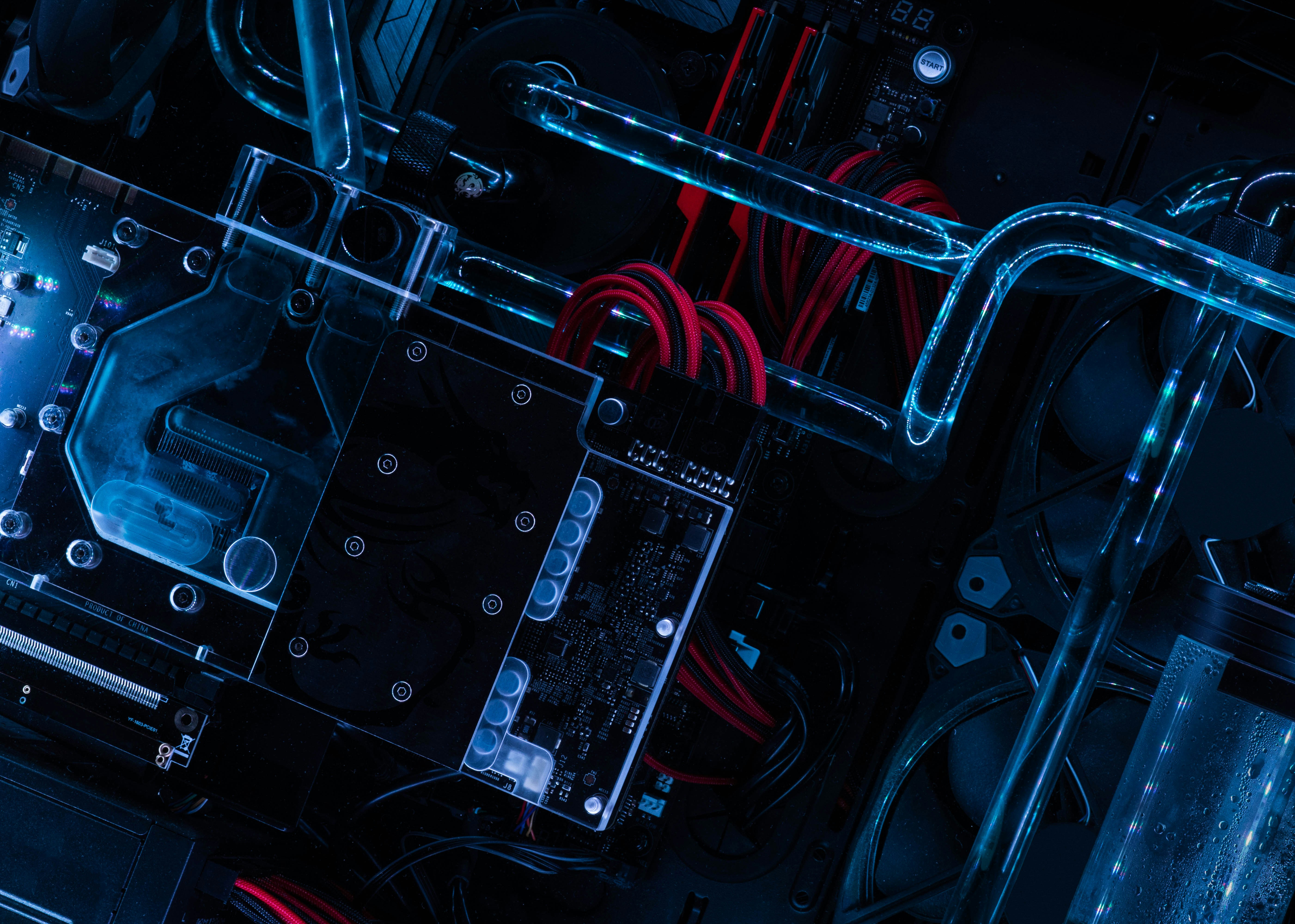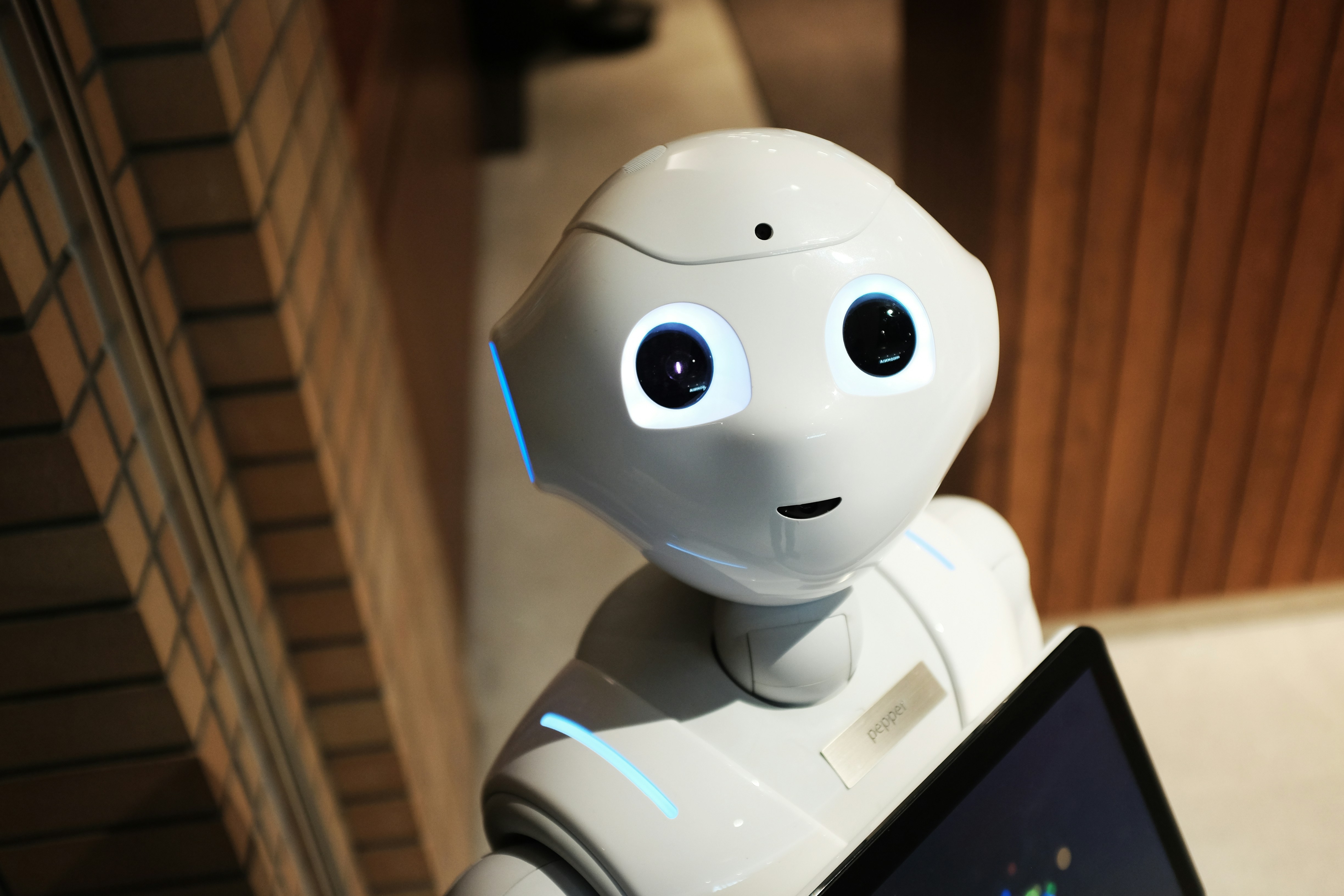Souveraineté numérique : les États peuvent-ils encore faire la loi face à Meta, X et TikTok ?
Souveraineté numérique : les États peuvent-ils encore imposer leurs lois à Meta, X et TikTok ?
Alors que les réseaux sociaux façonnent nos échanges, nos opinions et même nos perceptions, une question cruciale s’impose : l’État a-t-il encore les moyens de faire respecter ses règles face à des géants numériques comme Meta, X, TikTok ou Google ? À l’heure où l’Union européenne renforce son arsenal législatif, et où la France tente de reprendre la main, la bataille pour la souveraineté numérique ne fait que commencer.
Des plateformes mondialisées, des lois fragmentées
Meta (Facebook, Instagram), TikTok ou encore X (ex-Twitter) sont des entreprises privées, opérant à l’échelle mondiale, souvent depuis les États-Unis ou la Chine. Elles imposent leurs propres conditions d’utilisation, souvent opaques, qui ne coïncident pas toujours avec les législations locales.
Exemple : un contenu qualifié d’illégal en France peut rester en ligne si la plateforme estime qu’il ne viole pas ses propres règles internes. Cela crée un flou juridique et empêche les États d’appliquer efficacement leurs lois.
🔗 À lire sur CtrlZed : Meta, données personnelles, IA et Instagram : Ce que vous devez vraiment savoir.
Le DSA et le DMA : l’Europe sort les muscles
Face à cette asymétrie, l’Union européenne a pris l’initiative avec deux textes majeurs :
- DSA (Digital Services Act) – en vigueur depuis 2023
Imposition de règles strictes de modération,
Transparence sur les algorithmes,
Coopération obligatoire avec les autorités nationales.
- DMA (Digital Markets Act)
Limite les abus de position dominante,
Impose l’interopérabilité entre services,
Prévoit des sanctions jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial.
Ces textes marquent un tournant dans la régulation des plateformes. Mais leur application reste un défi concret.
🔗 Lire l’analyse du DSA sur Euractiv
La France renforce son arsenal
En parallèle, la France agit sur son propre terrain :
- La loi Avia (2020) sur les contenus haineux a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel.
- Mais l’ARCOM (ex-CSA + HADOPI) dispose désormais du pouvoir de sanctionner les plateformes non coopératives.
- En 2024, le gouvernement a évoqué des blocages temporaires de plateformes récalcitrantes.
Même TikTok a dû se plier à plusieurs exigences françaises, sous peine de restrictions d’accès.
Imposer la loi, oui… l’appliquer, c’est autre chose
En théorie, toute entreprise opérant sur le sol français ou européen doit se conformer au droit local.
Mais en pratique :
- Les plateformes jouent sur la multiplicité des juridictions,
- Elles disposent de ressources juridiques colossales,
- Certaines menacent de quitter des marchés (X/Twitter face au DSA),
- La mise en œuvre est souvent longue et politiquement délicate.
La souveraineté numérique se heurte à un mur : celui de la mondialisation des services numériques
Qui contrôle vraiment l’espace numérique ?

Au fond, cette bataille n’est pas qu’une affaire de droit : elle touche à la structure même de nos sociétés connectées.
- Qui décide des règles de modération ?
- Qui contrôle nos données ?
- L’espace public est-il encore public… s’il est détenu par des entreprises privées ?
La souveraineté numérique n’est pas une affaire technique, c’est un enjeu démocratique. Et elle nous concerne tous.
Un rapport de force encore instable
Les États et l’Union européenne disposent désormais d’un arsenal juridique sérieux (DSA, DMA, autorités nationales).
Mais cela ne garantit pas qu’ils aient repris le contrôle.
La souveraineté numérique se construit lentement, dans un rapport de force asymétrique.
Et pour qu’elle tienne, elle dépend aussi de nous, citoyens et usagers, pour exiger plus de transparence, de responsabilité et de régulation.
FAQ – Souveraineté numérique et régulation des plateformes
1. Le DSA oblige-t-il les plateformes à retirer les contenus illégaux ?
Oui, il impose une modération plus rigoureuse, avec des délais et une coopération avec les autorités nationales.
2. Les plateformes peuvent-elles être sanctionnées ?
Oui. Le DSA et le DMA prévoient des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial en cas de non-conformité.
3. Pourquoi est-ce si difficile d’imposer le droit local ?
Les plateformes sont souvent basées à l’étranger, jouent sur les juridictions, et disposent de moyens juridiques puissants.
4. L’ARCOM a-t-elle du pouvoir en France ?
Oui. Elle peut demander des comptes aux plateformes, imposer des mesures correctives, voire bloquer temporairement un service.
5. Que puis-je faire, en tant qu’usager ?
Signaler les abus, utiliser vos droits RGPD, exiger plus de transparence. La souveraineté numérique passe aussi par la pression citoyenne.
Auteur : Simon Nguene