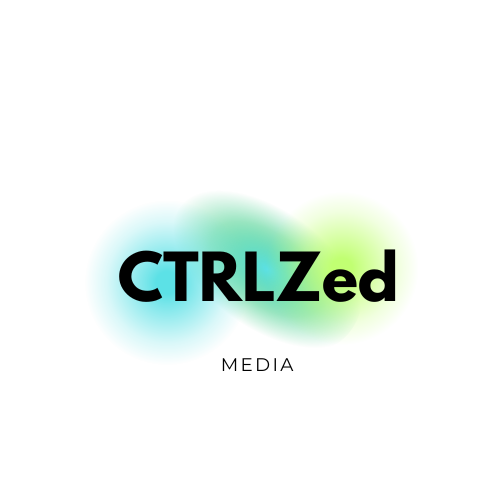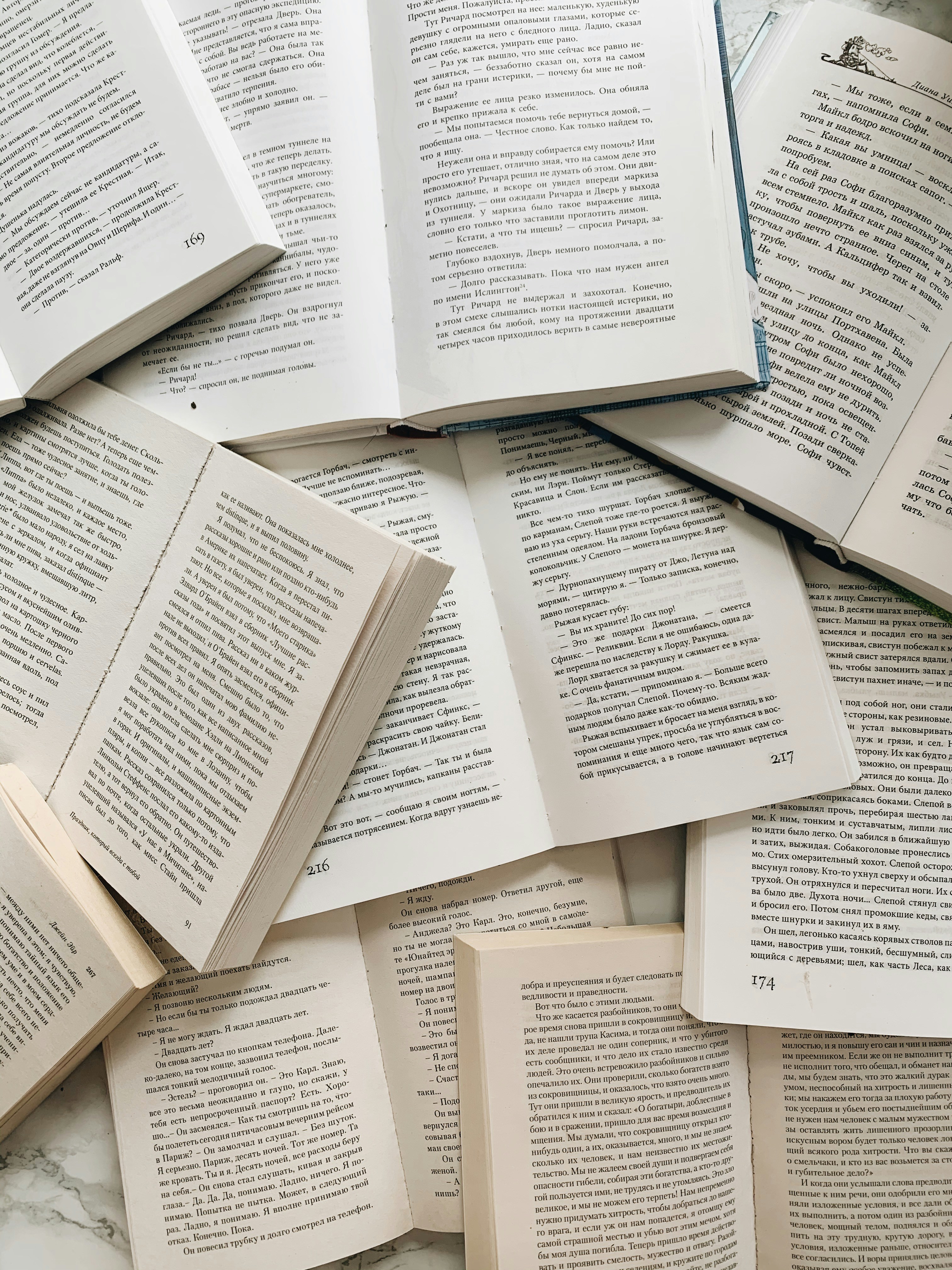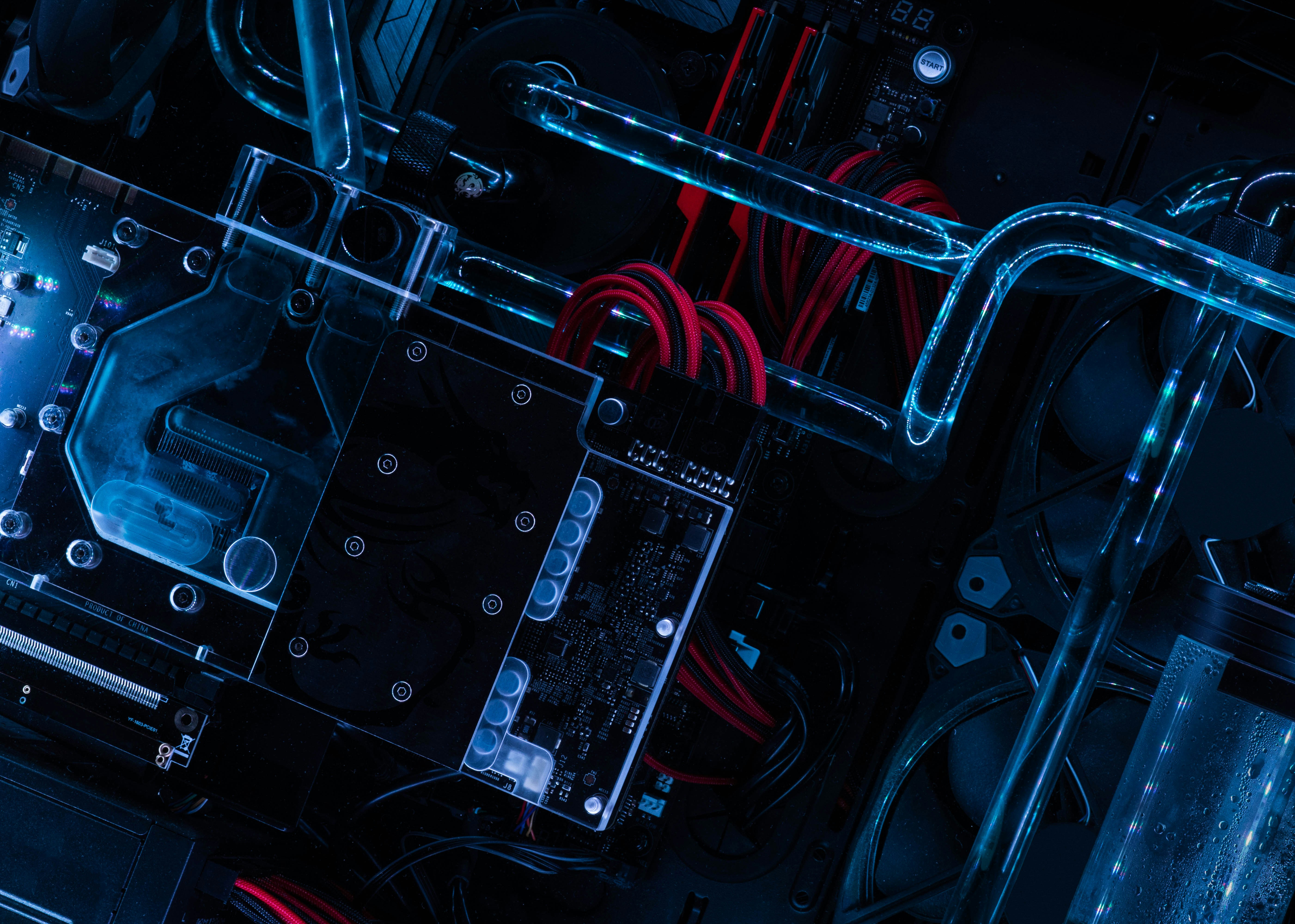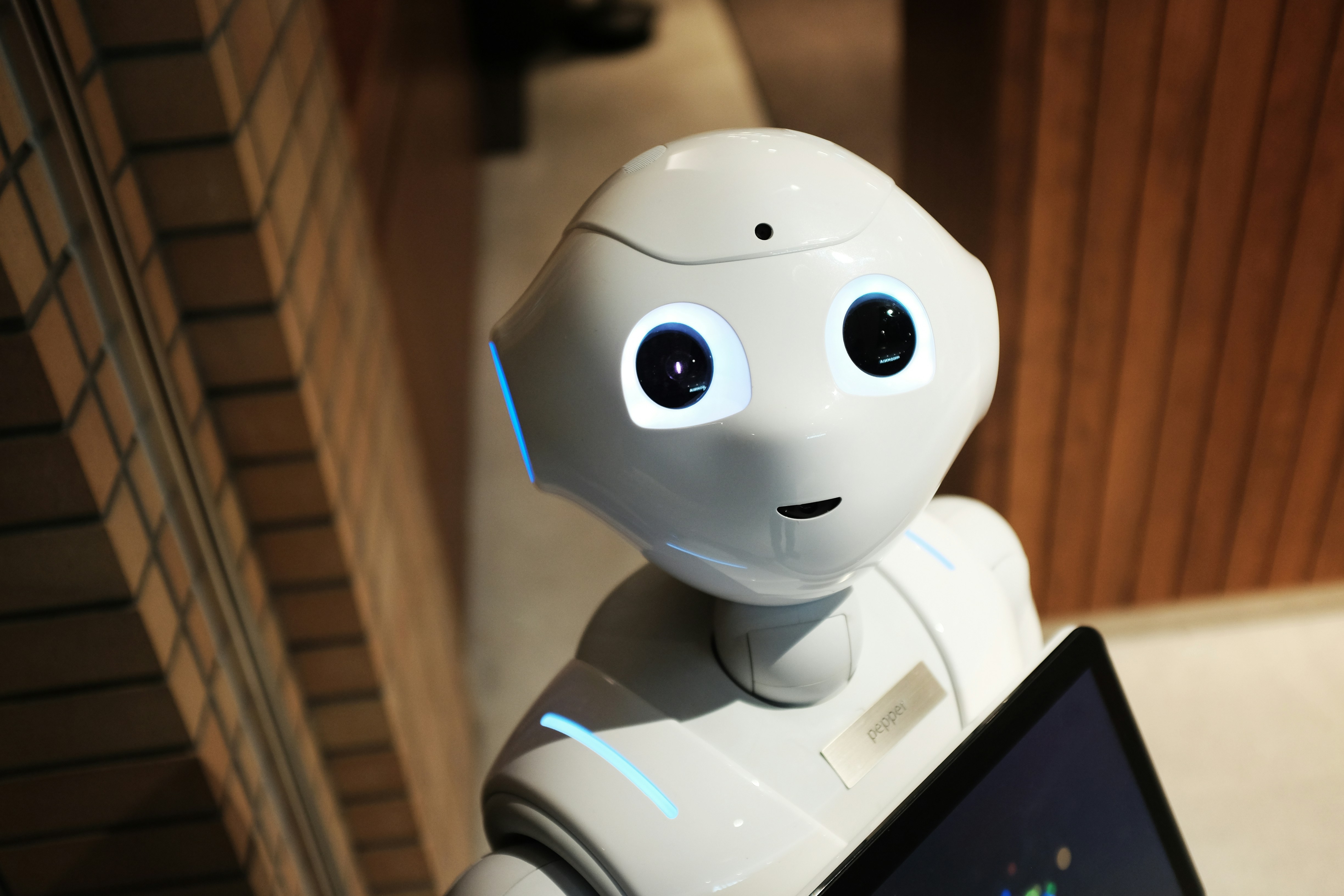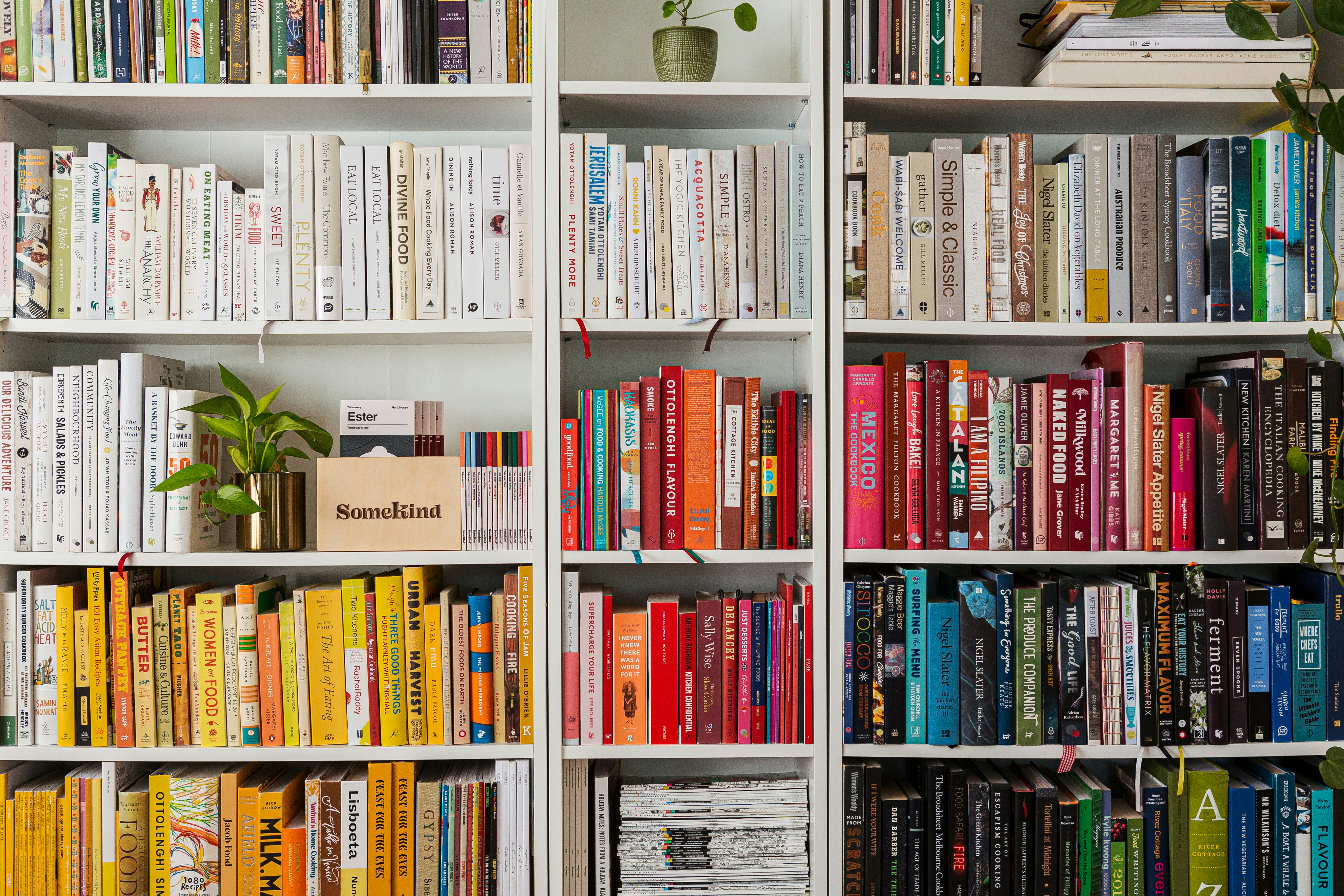
IA et droits d’auteur : un cadre juridique en mutation pour la France et l’Europe
L’IA et droits d’auteur sont au cœur d’un débat juridique, culturel et économique qui prend de l’ampleur. L’essor de l’intelligence artificielle générative bouleverse de nombreux secteurs : création artistique, médias, publicité, mais aussi le droit. Qui détient les droits sur une œuvre générée par une machine ? L’utilisateur qui saisit un prompt, l’éditeur du modèle d’IA, ou personne ?
En France comme en Europe, le débat s’intensifie, alimenté par des décisions de justice et des prises de position d’artistes. Le cadre juridique, jusqu’ici hésitant, entre dans une phase de mutation à l’approche de l’entrée en vigueur de l’IA Act européen (2025-2026).
IA et droits d’auteur en France : la règle actuelle

En droit français, le Code de la propriété intellectuelle (CPI) stipule qu’une œuvre doit être originale et refléter « la personnalité de son auteur » pour être protégée. Or, une IA n’ayant pas de personnalité juridique, elle ne peut être reconnue comme auteur.
Conséquence : un contenu généré uniquement par IA n’est pas protégeable en tant qu’œuvre de l’esprit.
Cependant, la jurisprudence nuance :
- Si l’utilisateur humain exerce une démarche créative manifeste (choix du prompt, retouches, intégration dans une œuvre plus large), il peut revendiquer la paternité de la partie humaine.
- Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a confirmé en 2023 que l’intervention humaine substantielle reste déterminante.
Exemple : une image générée par MidJourney sans modification n’est pas protégée. Mais un graphiste qui affine le prompt, combine plusieurs images et les retravaille peut obtenir la protection juridique.
IA et droits d’auteur en Europe : transparence et harmonisation
Au niveau européen, deux grands textes structurent le débat sur l’IA et droits d’auteur :
- Directive (UE) 2019/790 : encadre l’usage des œuvres protégées par des services numériques et introduit de nouveaux droits voisins.
- IA Act (2024, application 2025-2026) : impose aux fournisseurs d’IA générative des obligations de transparence, notamment la mention obligatoire lorsqu’un contenu est produit artificiellement.
Concrètement, une vidéo publicitaire ou un article généré par IA devra préciser son origine artificielle. Cette mesure vise à protéger le consommateur et renforcer la traçabilité.
Cependant, la protection par le droit d’auteur restera conditionnée à un apport créatif humain.
IA et droits d’auteur : les zones grises juridiques
Malgré ce cadre, plusieurs zones d’incertitude persistent et risquent d’alimenter des litiges :
1. L’entraînement des IA : droit de citation ou violation massive ?
Les grands modèles (GPT, MidJourney, Stable Diffusion) ont été nourris de millions d’images, textes, musiques et vidéos, dont une partie protégée par le droit d’auteur.
- Les éditeurs d’IA invoquent souvent l’exception de text and data mining (TDM) prévue par la directive européenne de 2019.
- Les artistes rétorquent que l’extraction massive et systématique dépasse cette exception et nécessite une licence préalable.
En pratique, une œuvre utilisée pour entraîner un modèle peut être diluée statistiquement, mais certains outputs reproduisent des styles identifiables (cas d’images imitant de grands illustrateurs).
2. La part humaine dans les œuvres hybrides
À quel moment une œuvre générée par IA devient-elle une création protégeable ?
- Suffit-il d’un prompt complexe ?
- Ou faut-il une intervention manuelle (retouches graphiques, réécriture, montage) ?
La frontière reste floue. La doctrine parle d’« originalité en cascade », où la protection ne peut porter que sur la partie créée par l’humain, pas sur la génération brute.
3. L’utilisation commerciale : un faux « no man’s land »
Certaines entreprises considèrent les images générées par IA comme des « biens sans maître », donc libres de droits. Or, ce raisonnement pourrait être contesté :
- Si l’image reprend un style protégé, elle pourrait être considérée comme une contrefaçon indirecte.
- Si une base d’entraînement a été constituée sans licence, l’éditeur du modèle peut être attaqué.
Résultat : beaucoup d’entreprises hésitent encore à intégrer massivement l’IA générative dans leurs campagnes publicitaires ou leurs produits, par peur d’un risque judiciaire futur.
IA et droits d’auteur : pistes de régulation

Face à ces incertitudes, plusieurs pistes sont discutées en France et en Europe :
1. Création d’un droit voisin spécifique à l’IA
Ce nouveau droit voisin permettrait de reconnaître la valeur économique des œuvres utilisées pour l’entraînement. Les créateurs recevraient une rémunération proportionnelle au volume d’utilisation de leurs œuvres.
Ce modèle est inspiré du droit voisin de la presse, adopté en 2019, qui a permis aux éditeurs de presse de négocier une rémunération avec Google et Meta.
2. Licences collectives obligatoires
Une piste soutenue par l’ADAGP et la SACEM : mettre en place une licence généralisée qui permettrait aux éditeurs d’IA d’utiliser les bases de données, mais en contrepartie d’un paiement centralisé redistribué aux créateurs.
Cela éviterait des négociations individuelles impossibles face à des milliards de contenus.
3. Transparence et traçabilité technique
Le marquage numérique obligatoire (« watermarking ») est une autre solution envisagée. Chaque œuvre générée par IA devrait contenir une signature numérique permettant d’identifier :
- le modèle utilisé,
- la date de génération,
- et le niveau d’intervention humaine.
Cela faciliterait la preuve juridique en cas de litige et la protection des créateurs.
4. Partage de la valeur via des fonds dédiés
Certains juristes suggèrent la création d’un fonds alimenté par les éditeurs d’IA, redistribué ensuite aux organisations de gestion collective.
Un système analogue à la copie privée pourrait être appliqué aux contenus générés artificiellement.
IA et droits d’auteur : impacts concrets pour les créateurs français
Les créateurs français devront :
- Préciser leur apport humain pour sécuriser la protection juridique.
- Surveiller l’utilisation de leurs œuvres dans les bases de données d’entraînement.
- Exiger transparence et rémunération auprès des éditeurs d’IA.
Les organisations professionnelles comme la SACEM, l’ADAGP ou la SCAM militent déjà pour un système équitable.
Vers une refondation du droit d’auteur à l’ère de l’IA

Le débat sur l’IA et droits d’auteur illustre la tension entre deux impératifs :
- protéger les créateurs et leurs revenus,
- stimuler l’innovation et la compétitivité européenne.
À court terme, il est peu probable que la France ou l’Europe reconnaissent une IA comme auteur. En revanche, les œuvres hybrides vont devenir la norme, et leur traitement juridique devra être clarifié par la jurisprudence.
Les prochaines années verront :
- l’émergence de litiges emblématiques (comme Getty Images vs Stability AI aux États-Unis, transposables en Europe),
- l’application du principe de transparence de l’IA Act,
- et probablement la mise en place d’un mécanisme de partage de la valeur (licences, fonds, droits voisins).
La véritable question n’est donc pas seulement « qui est l’auteur ? », mais « comment répartir équitablement la valeur créée par l’IA entre innovation et culture ? ».
L’IA et droits d’auteur ne doivent pas être perçus comme un frein à la création numérique, mais comme une opportunité de bâtir un cadre équilibré, capable d’assurer la soutien aux artistes tout en permettant aux entreprises européennes de rester compétitives face aux géants américains et chinois.
FAQ : IA et droits d’auteur
1. Une œuvre générée par IA est-elle protégée automatiquement par le droit d’auteur ?
Non, seule une œuvre présentant une intervention humaine originale peut bénéficier d’une protection.
2. Puis-je utiliser librement une image générée par MidJourney ou DALL·E ?
Oui en principe, mais attention : des litiges pourraient surgir si l’image reprend des éléments provenant d’œuvres protégées.
3. Les artistes seront-ils rémunérés si leurs œuvres servent à l’entraînement d’une IA ?
Pas encore. Mais des pistes de régulation comme la licence obligatoire ou le droit voisin de l’IA sont à l’étude.
4. Une entreprise peut-elle exploiter commercialement du contenu généré par IA ?
Oui, mais elle doit vérifier l’absence de risques juridiques liés aux bases d’entraînement.
5. L’IA Act va-t-il créer un nouveau droit d’auteur ?
Non. Il impose surtout des obligations de transparence et laisse aux États le soin d’adapter leur législation.